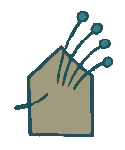TravailOn t’appelle travail. Tous les matins, tu nous attends. Nous venons, et nous te servons. Tu demandes toujours un peu plus qu’on ne peut donner. Ta face large et plate ne bouge pas quand on le dit. Tu es sourd. Au sommet de l’année, la fatigue nous prend. Tu n’aimes pas les gens fatigués. Tu les laisse partir quinze jours, trente. En sortant, ils ne cassent pas le manche de leur outil, ils le rangent, ils lui disent : « À bientôt ». Ils savent que tu es là, sphinx dans leur dos. Georges-Louis Godeau – Carton – © le pavé, 1984 |
Signe pour le départ au travailDans la nuit Salut à votre éveil Et je vais travailler Dans la nuit Gabriel Cousin in Nouveau trésor de la poésie pour enfants, Anthologie par Georges Jean – le cherche midi, 2003 |
|
Les odeurs des métiersJe connais l’odeur des métiers : Gianni Rodari – La tête du clou – Lo Païs, 1996 |
||
Au travail !Seize ans. Tu quittes le collège. Un jour. Un autre. Un mois. Le froid. On t’indique la route à suivre. Sa vie, chaque jour, on la perd. Et si le patronat s’inquiète Jacques Charpentreau – Le Romancero populaire – Les Éditions Ouvrières, 1974 |
Vous me croyez soumis au rythme des machines, Obéissant à leurs signaux, dans le meilleur Des mondes bétonnés, sans honte, sans frayeur, Mécanisé, repu et souple de l’échine. Mais mon cœur est ailleurs. Je suis sur la crête des vagues, dans l’écume Jacques Charpentreau – Le Romancero populaire – Les Éditions Ouvrières, 1974 |
|
|
En blousons et casquettes À cyclo ou vélo Ils quittent le boulot Et ce n’est pas la fête Ils sortent à six heures Ils laissent au vestiaire En blousons et casquettes Ils pensent que demain À cheval sur leurs rêves Joël Sadeler – Vingt-neuf fois sur le métier – Corps Puce / J.P.L. COM’, 1992 |
||
| Deux lunes noires rabattues lui font des yeux de crustacés. Il tient parfois des pinces. Alentour, pas l’ombre de la mer, le bleu, c’est juste un trait d’étincelles qui fuse entre les mains. Ainsi fond, fond, fond le métal à la flamme : elle est bleue sa couleur, mais les yeux, va savoir, mais les yeux pour l’instant sont tout noirs. Bruno Berchoud – Leurs mains – © Cheyne éditeur, collection « Poèmes pour grandir », 2005 |
Soudure électriqueDes couteaux bleus, verts, jaunes déchirent les verrières, blessent le regard et la nuit. Gabriel Cousin in Nouveau trésor de la poésie pour enfants, Anthologie par Georges Jean – le cherche midi, 2003 |
|
MécanicienJ’aimerais voir, dans le reflet de tes mains, tourner sans faille ni à-coups mon moteur poétique. Jean-Michel Bongiraud – Les mots du manœuvre – l’épi de seigle, 1998 |
||
|
Le mécano Joël Sadeler – Vingt-neuf fois sur le métier – Corps Puce / J.P.L. COM’, 1992 |
Quelle prise maintenir sur la vie ? Notre humeur multiple, comme une pince, serre ou desserre les crans au gré des sentiments. Si la poigne devient trop lâche, le corps risque d’être déboulonné de l’existence. Nul doute qu’il vaut mieux avoir l’esprit ferme et assuré. L’écrou n’est pas interchangeable et toute la tension s’exerce sur une seule vie. Jean-Michel Bongiraud – Mots d’atelier – le dé bleu, 1997 |
|
Être de boisCelui qui décréta N’a jamais caressé À Claude Laroche Béatrice Libert – La sourde oreille et autres menus trésors |
||
Monter la grueMonter la grue sur un nouveau chantier est un plaisir. Je porte les barres comme un lanceur de javelot, je les lève et les tiens comme un équilibriste et j’ai encore le temps de caler mon béret à cause du soleil. Il gèle dur mais je préfère cent fois ma place à celle des gens de bureau qui nous regardent travailler derrière leurs vitres. Ils sont enfumés. Je parie qu’ils ont les pieds froids. Moi je respire à pleins poumons et marche sur la braise. Georges Louis Godeau – La vie est passée – le dé bleu, 2002 |
La chaîneLa chaîne cliquette en dépliant ses vertèbres. Pierre Béarn – Couleurs d’usine – © Seghers, 1951 |
|
Un marteauFait pour ma main, Tu dors longtemps, Je te touche et te pèse, Je remonte avec toi Tu me ramènes, Guillevic – (Sphère) in Le livre d’or des poètes, Anthologie par Georges Jean – Seghers, 1973 |
||
| Sur son pèse-lettre la postière pèse les mots d’aujourd’hui et d’hier Elle sait Elle connaît Elle reconnaît aussi Mais elle s’en balance Joël Sadeler – Vingt-neuf fois sur le métier – Corps Puce / J.P.L. COM’, 1992 |
FraiseurLe monde est fait d’ordre. Et chacun appartient à un ordre. Celui qui contemple, pour juste et grand que soit son esprit, ne peut combattre la misère. Celui qui se bat, pour fort et puissant que soit son corps, ne peut vaincre la haine. Jean-Michel Bongiraud – Les mots du manœuvre – l’épi de seigle, 1998 |
|
Le temps perduDevant la porte de l’usine Jacques Prévert, Paroles, Gallimard, 1949 |
||
|
Inutile de s’exclamer. Il faut crier. Avant que la pointe de nos désirs ne soit meulée, que l’angle de nos passions ne soit arrondi, que le restant de courage ne soit avalé, et sans attendre la fusion de l’esprit et du cœur ! Jean-Michel Bongiraud – Mots d’atelier – le dé bleu, 1997 |
Pour serrer le cœur jusqu’à l’étouffement, les vieux outils sont encore les plus subtils ; l’étau, le chalumeau, la haine, la vengeance… Pour ceux qui les manient, le travail est sans surprise. Dommage que la mort ne soit pas plus brave. Les prendrait-elle de face, qu’ils croiraient encore que c’est un nouveau jeu ! Jean-Michel Bongiraud – Mots d’atelier – le dé bleu, 1997 |
|
SélectionsIls ont moins de vingt ans. Ils sont seuls dans un champ de blé. Lui est à genoux. Il broie dans sa main le plus bel épi. Elle se penche sur lui pour voir de plus près. Tête contre tête, ils parlent doucement de terre, d’engrais et de semences. Georges-Louis Godeau – Votre vie m’intéresse – © éditions le dé bleu, 1985 |
||
Le déménageurGaétan porte des armoires sur son dos. Quand il s’arrête dans l’escalier pour allumer sa pipe ou pour causer un brin avec monsieur le professeur de philosophie, le meuble reste en équilibre, bien sage, sur l’échine. Georges-Louis Godeau – Votre vie m’intéresse – © éditions le dé bleu, 1985 |
Le tôlierMon père était forgeron. Le soir, il lisait des revues de métallurgie. Moi aussi, je lisais. Les usines d’avion. Je rêvais. Georges-Louis Godeau – Votre vie m’intéresse – © éditions le dé bleu, 1985 |
|
La même choseJ’écris des poèmes, des poèmes, et mon frère fait des paniers, des paniers. Georges-Louis Godeau – Votre vie m’intéresse – © éditions le dé bleu, 1985 |
||
Le boueurBoueur, je te reconnais quand je te croise l’après-midi, pour t’avoir regardé souvent, le matin, courir derrière ta benne, courir sauter, jeter, recommencer. Georges-Louis Godeau – Votre vie m’intéresse – © éditions le dé bleu, 1985 |
Le chaudronnierMa mère est morte, ma femme est folle et je n’ai pas d’enfant. Alors, je bois du vin rouge et je gueule. Georges-Louis Godeau – Votre vie m’intéresse – © éditions le dé bleu, 1985 |
|
Le quincaillierOn l’a rétamé le quincaillier Constantin Kaïtéris – Le quincaillier, la remailleuse et autres métiers perdus – Corps Puce, 2017 |
||
Le chèqueC’est un chantier sans hommes presque. L’hiver les a chassés l’un après l’autre. Les quatre survivants font le travail de tous. Georges Louis Godeau – La vie est passée – le dé bleu, 2002 |
Monsieur Je suis caissière au supermarché, vous videz votre caddy, je décompte. Reste la caisse d’eau minérale que vous renoncez à soulever car elle est lourde, et cachetée. « Pas de problème, dites-vous, douze bouteilles ». Que je marque l’arrêt vous étonne. Que j’ajoute « ouvrez » vous dépasse. Vos vieilles mains tremblent. Vous avez envie de me gifler. Tête basse, vous déchirez, montrez. Douze bouteilles sont là, honnêtes comme vous. Je ne m’excuse pas, je vous accorde simplement un regard dans lequel vous plongez pour voir mes raisons : mon métier, le règlement, il y a tant de voleurs ! Et vous ne savez comment vous confondre, m’offrir tout votre soleil intérieur, me souhaiter bon courage. J’en ai. Merci. Au suivant. Ouvrez. Georges Louis Godeau – Carton – le pavé, 1984 |
|
|
J’ai vu le menuisier J’ai vu le menuisier J’ai vu le menuisier J’ai vu le menuisier J’ai vu le menuisier Tu chantais, menuisier, Je garde ton image Moi, j’assemble des mots Guillevic – Terre à bonheur – © Seghers, 1952 |
||
Rire aux éclatsL’artboisier Il sait que le bois Qu’il danse Et qu’il n’a pas son pareil Et pour créadivaguer Pour Daniel Bulinckx Béatrice Libert – La sourde oreille et autres menus trésors – |
Les hommes ont levé l’ancre. *** Il y a toujours, Leurs yeux cherchent les passerelles © Gérard Cousin |
|
 © Pierre Rosin |
||
|
Les vieux ouvriers compensent par l’astuce la lenteur de leurs gestes. Ils repassent parfois leur savoir-faire à des jeunes qu’ils estiment. Mais côté cœur, personne n’a encore vraiment acquis le tour de main. Si aucune école n’est ouverte à cet enseignement, certains ont les mots pour nous faire croire qu’ils ont ce diplôme. Mais bien souvent la pratique leur fait défaut. Jean-Michel Bongiraud – Mots d’atelier – le dé bleu, 1997 |
Et la fête continueDebout devant le zinc Jacques Prévert – Paroles – Gallimard, 1949 |
|
LibertéÀ l’usine, quand je suis parti, ils m’ont dit : « Veinard ! Tu es libre ». À corps perdu j’ai foncé dans le terrain vague pour voir la grande dame. Elle n’était nulle part. Georges-Louis Godeau – Carton – © le pavé, 1984 |
Nous sommes les nouveaux prolétaires
Dans cet univers où tout est toujours nouveau
nous sommes ceux qu’il faut appeler les nouveaux prolétaires car si l’ancienne exploitation s’affuble toujours de visages nouveaux
dans nos temps très modernes la vieille misère est
toujours aussi jeune.
Nous travaillons dans des ateliers et des chantiers, derrière des machines
à commandes numériques, des tours, des fraiseuses, des presses, des emboutisseuses
nous sommes des millions, nous travaillons pour des
patrons, sous-traitants maltraités ou multinationales
mais l’ère de l’industrie étant déclarée close, nous
n’existons pas.
Nos usines ont été fermées ; nous avons été libérés de
notre travail
mais, toujours à la recherche d’un emploi, du travail nous ne sommes pas libérés.
Quant à nous qui sortons de l’école, et n’avons jamais eu emploi, ni vrai salaire
de stages gratuits en petits boulots, pour presque rien,
nous travaillons sans cesse.
Nous sommes les prolétaires de l’ère post-industrielle ;
on nous dit que l’ordinateur libère
mais nous passons nos journées enchaînés à nos ordinateurs.
Ce n’est plus seulement notre main, mais notre cerveau et nos nerfs qui deviennent les appendices de la machine.
Ouvriers, employés, chômeurs ou précaires,
nous sommes les nouveaux prolétaires.
Dans cet univers où seule compte la propriété,
de notre emploi,
nous ne sommes pas même les propriétaires.
Nous sommes les nouveaux prolétaires.
Ne possédant rien, nous ne comptons pour rien.
Mais nous sommes les plus nombreux,
sans nous rien ne se fait.
Et ceux qui possèdent tout,
avec nous devront compter.
Francis Combes – Cause commune – Le Temps des Cerises, 2003