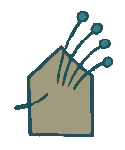|
Jennifer Foester fait partie de la jeune génération de poètes Indiens d’Amérique dont la voix surprend, secoue, enchante, nourrit. Que ce soit Sherwin Betsui, Erika Wurth, Layli long Soldier, pour n’en citer que trois autres, on pénètre avec eux dans un univers mental et une réalité qui élargit nos perceptions aussi bien que notre compréhension du monde et de ses phénomènes. Elle poursuit ainsi la voie tracée par les générations précédentes avec des auteurs comme Gerald Vizenor, Louise Erdrich, Leslie Silko ou encore Norman Scott Momaday, dont on a relevé soit le réalisme magique soit le réalisme mythique. Le naturel et le surnaturel sont intimement liés mais jamais ne tombent dans le fantastique, ont toujours à voir avec une interprétation ouverte sur le spirituel du monde et l’imaginaire mythologique propre à ces cultures Indiennes d’Amérique du nord. Jennifer a obtenu un master d’écriture créative à l’université des beaux-arts du Vermont et sa licence à l’institut des arts amérindiens de Santa Fe, état du Nouveau Mexique. Elle a obtenu des bourses afin de suivre des programmes d’écriture créatives à l’institut Naropa, à Dorland Mountain Arts Colony, au Vermont Studio Center, ainsi qu’à l’université de Stanford. Publiés dans les magazines de poésie ses poèmes sont également présents dans des anthologies dont Poetry from the Indigenous Americas. |
|
Son premier livre intitulé Leaving Tulsa a été édité par University of Arizona Press ce qui déjà en soi est la marque d’une reconnaissance. Ce livre semble avoir été écrit dans un état de perpétuel rêve éveillé, une sorte de transe due à des milliers de kilomètres parcourus sur les routes. Ayant des origines Hollandaises et Allemandes elle est avant tout membre de la nation Muscogee (encore appelée Creek) de l’état d’Oklahoma. Fille d’un diplomate, Jennifer a grandi dans divers pays mais elle a passé tous ses étés à Jenks, en Oklahoma, avec ses grands-parents Indiens. Elle vit maintenant à San Francisco où elle est écrivain free-lance et conseillère pour les associations (afin d’obtenir des subventions). Sa poésie explore son double héritage culturel dans une société américaine qu’elle critique. Ses poèmes ont une tonalité bien à elle, il s’agit bien souvent de poèmes-paysages capturés sur la route empruntée pour visiter l’histoire et revenir à ses racines, à l’identité Indienne. Identité qu’il faut, pour certains, reconstituer à partir de bribes de récits, au sein d’un peuple presque brisé qui survit, résiste et regagne en dignité, en espoir, en valeurs propres à sa culture malgré la société blanche et les courants occidentaux majoritaires aux Etats-Unis. Voici deux poèmes tirés de Leaving Tulsa qui sont reproduits avec l’aimable permission des éditions University of Arizona Press. |
|
FugueI was born in a blizzard in the vault of a clavier. My mother’s ribs were icicles, the wind a compass of octaves, even her pulse a prelude. Skimming the frozen meadows I learned the flight of night swallows, licked stars from the snow. This is how my bones grew. Eight winters old I began to bleed, sealed the chalice beneath the keys— my daughter’s hands bloomed edelweiss. I taught her to twine the diatone through the carpals of her wrist— she was my organ, I her voice. She at the pedals with hammers and nails: a cross composed by counterpoint. I recited the passion in sequence because mother favored baroque, drank teas of birch bark, alpine rose to drown the sound of wolves. Sheared my graying hair, wove it through the strings because I wanted to arrange my immaculate death. When I tied stones, like bells, to my ankles and dove into the Danube my daughter heard a requiem. It was winter. She did not find me for days: face-down on an iced-over harpsichord, plucking scales from my mother’s tongue with my teeth. FugueJe suis née dans un blizzard dans la voûte d’un clavier. Les côtes de ma mère étaient des glaçons, le vent un compas d’octaves, son pouls même un prélude. Ecumant les prés gelés j’appris le vol des hirondelles nocturnes, léchais les étoiles depuis la neige. C’est ainsi que mes os ont grandi. Agée de huit hivers j’ai commencé à saigner, je scellai le calice sous les clés— les mains de ma fille ont fleuri edelweiss. Je lui appris à enrouler le hautparleur par les canaux carpiens de son poignet— elle était mon orgue, moi sa voix. Elle aux pédales avec marteaux et clous : une croix composée par contrepoint. Je récitais la passion par séquence parce que maman préférait le baroque, buvais des tisanes d’écorce de bouleau, rose des alpes pour noyer le bruit des loups. Ai tondu mes cheveux gris, les tissais aux cordes parce que je voulais organiser ma mort immaculée. Quand j’attachais les os, en guise de cloches, à mes chevilles et plongeais dans le Danube ma fille entendit un requiem. C’était l’hiver. Pendant des jours elle ne me trouva pas ; tête en bas contre une harpe couverte de glace, j’arrachais des écailles à la langue de ma mère avec mes dents. |
|
Tracing Magdalena1. In the distance, a forest. I thread your light through the trees, cross-stitch the canal of your throat. Stitching on canvas is a way of stepping over the river to gather material from the other side. Pine. Birchbark. Patterns gnawed into white Undersides—traces I carry back across the waves where I hang your blue dress in the breezeway to dry— you in the doorframe aflame against the four edges of night. 2. How fast the twilight shifts across canvas. Lit by the last exhale of sun, a stream of birds glimmers over glass. Standing now in half-light at the boundary of a sea, I draw a line to demonstrate the emptiness. Shades of gray receding to snow, miles yet to travel across the frozen sound. Sur les traces de Magdalena1. Au loin, une forêt. J’enfile la lumière par les arbres, je suture au point de croix le canal de ta gorge. Broder sur la toile est une façon de passer par-dessus la rivière pour collecter du matériel de l’autre côté. Pin. Ecorce de bouleau. Motifs rongés au blanc en dessous—traces que je transporte au travers des vagues auxquelles je suspends dans la brise ta robe bleue pour qu’elle sèche— toi dans l’encadrement de la porte enflammée contre les quatre bords de la nuit. 2. Comme le crépuscule passe vite sur la toile. Allumé par le dernier souffle du soleil, un flot d’oiseaux miroite au-dessus du verre. Maintenant dans la pénombre à la limite de la mer, je tire un trait pour démontrer le vide. Des ombres grises reculent vers la neige, des kilomètres encore à conduire au travers du son gelé. |