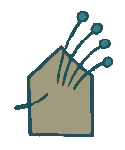Le traducteur est traducteur quand il donne à entendre ce que fait le poème et pas seulement ce qu'il dit.
Henri Meschonnic – Vivre poème, éditions Dumerchez, 2006
Faut-il tout dire ? Comment dire tout ? Passer d’une langue à une autre suppose le projet (idéal) de faire coïncider deux codes, la langue d’arrivée devant refléter aussi fidèlement que possible la langue de départ. En utilisant le verbe “refléter” j’ai conscience de ce que cela implique de différence: il y a toujours quelque chose de bougé entre le modèle et sa représentation. Par ailleurs, en arrière-plan, une constante – un noyau indestructible – s’impose discrètement à l’esprit: en traduisant, nous savons d’instinct que, d’un peuple à un autre, d’un groupe linguistique à un autre, aussi différents que soient les divers supports de la communication, une pensée sous-jacente court – une pensée que nous avons, dans ses grandes lignes, en partage. Quand Mishima demande que les nouvelles de La mort en été soient traduites de l’anglais en français et non à partir de la version originale japonaise il suppose une continuité pas trop perturbée par le glissement (la translation, dirait l’anglais) de la langue 1 vers la langue 2 puis la langue 3.
Oui, me dira-t-on, cet exemple est sans doute valable pour la prose, mais la poésie… la poésie ne propose-t-elle pas au traducteur un matériau plus complexe, plus transformé (par rapport aux normes de la langue considérée), plus sensible? Cette distinction me paraît peu fondée. Je dirai même qu’elle a le don de m’exaspérer. Que certains textes (en prose ou en poésie) soient plus difficiles que d’autres à traduire, j’en conviens volontiers; que la poésie pose plus fréquemment des problèmes, j’en conviens aussi. Ce qui m’inquiète au premier chef, c’est le statut faussement privilégié qui risque de résulter de ce type de discours: à trop mettre la poésie sur un piédestal on l’isole. Elle n’est pas au-dessus, elle est autre. Il se trouve que pour moi elle est indispensable – l’air que je respire aussi m’est indispensable – il ne me viendrait jamais à l’idée de dire que l’air est supérieur ou indicible ou… intraduisible. Le mot “air” fait ce qu’il peut: il approche l’air, l’évoque dans sa légèreté même (tel ce regard qui contourne au plus près l’Urne grecque de Keats) – le mot “air” ne vise pas à exprimer l’aérité, il donne à voir et à entendre.
Dans le vrai-faux débat prose/poésie, où se situe le Finnegans Wake de Joyce ? C’est un défi pour le traducteur – il s’agit de sculpter sans cesse dans le matériau de plusieurs langues européennes, à la manière d’un Giacometti. Cela demande une patience, une culture, un travail, une réflexion que j’admire. On me répondra que Joyce est l’exception qui confirme la règle: il a atteint le point limite où prose et poésie se rejoignent comme font les parallèles dans un système non-euclidien. Soit. Mais la difficulté est partout, même dans la prose apparemment la plus limpide. Prenons le passage de Hamlet (acte V, scène 1) où les fossoyeurs (two clowns / deux rustauds) discutent entre eux tout en creusant la tombe d’Ophélie. “The crowner hath sat on her, and finds it Christian burial” / “ le magistrat a siégé sur elle, et conclu à la sépulture chrétienne”: le jeu de mots portant sur sat est rendu par une petite bizarrerie en français; en outre, l’anglais fait naître une image plus brutale dans la confusion établie entre sens littéral et sens figuré: le magistrat instructeur, représentant de la couronne (crown) semble à la fois siéger avec toute la dignité que lui confère sa fonction et être réellement assis sur le cadavre d’Ophélie (laquelle, par son suicide, a eu le tort d’enfreindre les lois et normes établies; “si elle n’était point femme de qualité”, ajoute notre rustaud, “elle n’aurait pas eu sépulture chrétienne”). La traduction n’a pu rendre dans sa totalité les rapports subtils inhérents au champ sémantique de sat; elle tend vers cette totalité, elle la suggère le mieux possible avec les matériaux à sa disposition, sans tomber dans un schéma explicatif.
Plus loin, Hamlet engage la conversation avec le premier fossoyeur et, tenant compte, là aussi, de sa situation dans l’espace (le rustaud est dans la tombe qu’il creuse) déclare: “I think it be thine indeed, for thou liest in it” / “je pense qu’elle est à toi en ce sens que tu es dedans.” L’ambiguïté repose sur deux verbes homonymes (lie/lie: être couché, se trouver, être dans un lieu / mentir). Le traducteur doit accomplir une acrobatie transformationnelle sans pour autant diluer le texte dans des périphrases; c’est ce que fait François-Victor Hugo avec beaucoup d’élégance lorsqu’il traduit la dernière réplique du fossoyeur: “’Tis a quick lie, sir: ‘twill away again, from me to you” / “Démenti pour démenti. Vous voulez me mettre dedans en me disant que je suis dedans.” C’est rapide, c’est efficace, et pourtant, quelque chose manque: quick reprend en sourdine le mot utilisé dans la phrase précédente par Hamlet… dans un autre sens: “[…] ‘tis for the dead, not for the quick […]” / “elle [la tombe] est pour les morts et non pour les vivants”. La langue est d’une telle richesse qu’un jeu de mots développé sur plusieurs répliques (portant sur lie) en cachait un autre, fugitif, discret (quick: rapide / vif; exemple: “he was hurt to the quick by the remark” / “cette remarque l’a piqué au vif”). C’est dire l’immensité de la tâche: le traducteur, tel Sisyphe, déplace son rocher et, sous le rocher, une petite pierre roule… un grain de sable. Faut-il renoncer pour autant? La difficulté stimule, me semble-t-il, le traducteur. Elle lui fait donner le meilleur de lui-même. Il sait qu’il ne peut pas tout restituer de l’original, mais il ne renonce jamais. D’ailleurs, dans les circonstances les plus ordinaires où nous faisons usage de notre propre langue, pouvons-nous tout dire, savons-nous tout dire? – n’y a-t-il pas toujours une part cachée où la langue murmure, hors de toute intention immédiate, autre chose qu’un “message” que nous croyions naïvement univoque ?
Voyons un dernier exemple tiré de Shakespeare. Dans la même scène, Hamlet, incognito, incite le fossoyeur à parler à bâtons rompus de… Hamlet. Hamlet: “How came he mad?” First Clown: “Very strangely, they say.” Hamlet: “How ‘strangely’?” First Clown: “Faith, e’en with losing his wits.” Hamlet: “Upon what ground?” First Clown: “Why, here in Denmark […].” / “Comment est-il devenu fou?” “Fort bizarrement, à ce qu’on dit.” “Pourquoi bizarrement?” “Sa tête est partie, ma foi!” “Où cela?” “Mais ici, en Danemark.” Le jeu de mots repose sur l’association d’idées impliquée par ground (sol, terrain / raison) héritée du vieil allemand (Grund, en allemand contemporain); en français, le rapport existe aussi entre les deux sens, mais dans des contextes nettement moins fréquents (he had no ground(s) for complaint / il n’avait pas lieu de se plaindre). Il est intéressant de noter que les ambiguïtés relevées dans ces trois extraits reposent, pour l’essentiel, sur des mots de la langue de tous les jours, d’origine germanique, dont le premier sens implique une situation dans l’espace (sit, lie, ground). Paradoxe, et non des moindres: ces mots simples, rendus plus simples encore par leur brièveté (une seule syllabe), proposant un lieu, une position, un repère, deviennent de plus en plus déroutants; ils contribuent à évoquer la situation équivoque d’Hamlet – par rapport aux personnages qui l’entourent et par rapport à lui-même.
L’honnêteté consiste à reconnaître que l’acte de traduire implique un risque, une perte – cette perte qui affecte d’ailleurs nos rapports quotidiens – entre le locuteur A et le locuteur B la communication ne fonctionne jamais à 100%, même dans des conditions de parfaite audition ; B n’a pas encore fini de décrypter une phrase de A que déjà une seconde phrase vient recouvrir la première, telle une vague ; B lance sa propre phrase, interrompt le cours, cherche le mot juste pour convaincre, A le devance, il y a tissage de sens, dérivations – dans l’échange, quelque chose s’égare nécessairement. La lecture, même attentive, n’échappe pas, à un moindre degré, à cette règle: des éléments nous échappent, des phénomènes extérieurs nous distraient; notre attention, aussi soutenue soit-elle, fait passer le principe de plaisir avant toute analyse textuelle – et n’est-ce pas mieux ainsi ?
Le traducteur, lorsqu’il travaille sur un document écrit, n’est pas condamné à une linéarité erratique; il peut se donner du temps, revenir en arrière, réfléchir, amender; son activité est traversée par ce paradoxe: il peut mieux cerner son objet et, ce faisant, il perçoit d’autant plus ce qui lui échappe dans le glissement qui s’opère insensiblement d’une langue à l’autre. E. E. Cummings offre un exemple remarquable du type de difficultés rencontrées, car il transforme par touches quasi imperceptibles le matériau de sa propre langue, donnant à lire et à entendre des mots-outils, des clichés, des mots apparemment de rien qui, légèrement décalés, gagnent en autonomie, en force, en ambiguïté aussi – le sens se déplace et, dans ce déplacement, il invite subtilement le lecteur à faire de même; ce dernier introduit son propre sens, sa propre dérive de sens – la langue témoigne d’une présence à travers un moment privilégié où le sens et le son semblent ne faire qu’un spontanément, effaçant d’un coup le travail, la mise en forme, la construction du poème. Le texte qui suit est extrait de Selected poems 1923-1958, Harmondsworth, the Penguin Poets, 1965.
no time ago il y a de ça jamais
or else a life ou bien une vie
walking in the dark marchant dans le noir
i met christ je vis le christ
jesus) my heart merde) mon coeur
flopped over bondit et
and lay still s’apaisa
while he passed (as tandis qu’il passait (aussi
close as i’m to you près que moi de toi
yes closer oui plus près
made of nothing fait de rien
except loneliness sinon de solitude
Lorsque j’ai traduit ce poème j’ai perçu assez rapidement ce que j’avais réussi à préserver de l’original (par exemple, les sonorités de la dernière ligne) mais aussi les insuffisances: l’allitération contenue dans “or else a life” n’est pas rendue en français; pire: la mise en croix du nom (la mise en chiasme: “i met christ / jesus…”) renvoie à la fois au sacré et au profane (“christ” et “jesus”, dans ce contexte, sont aussi des jurons à demi étouffés qui suggèrent l’étonnement du narrateur ou du témoin – disons, l’étonnement de ce je-qui-regarde: “merde”, “nom de dieu”, “bon dieu de bon dieu”…) – le français n’ayant pas d’équivalent direct pour évoquer ce double registre, ne peut suivre qu’à mi-chemin, par allusion. Il ne suffit pas de comprendre les strates de langue impliquées, encore faut-il pouvoir les restituer, les donner à ressentir. Il reste à espérer qu’un autre traducteur fera mieux. C’est aussi ça, la traduction: une suite d’approches, de sensibilités, de perspectives dans la continuité et dans la différence.
L’exigence du traducteur ne débouche-t-elle pas parfois sur un autre paradoxe ? N’éclaire-t-il pas par son exploration tenace des aspects du texte qu’un lecteur de la langue originale ne percevrait pas consciemment ? A la limite, ne donne-t-il pas à saisir des nuances qui auraient pu échapper à l’auteur lui-même ? En 1985, à l’initiative de Jacques Rancourt, Roger Garfitt et moi-même devions faire une lecture croisée de nos poèmes au Centre Pompidou. Nous préparions nos traductions ensemble. Roger arrivait aux dernières lignes de Déjeuner à l’Hôtel de la Pointe, Piriac (1982) lorsqu’il se pencha vers moi pour me demander ce que je voulais dire par “tu mets tes lunettes et / tout devient trop cru d’un coup”. Je découvrais, avec lui, que cru était à la fois un adjectif et un participe passé. Le cru, le cuit et le croire avaient soudain partie liée. Je n’avais pas joué avec les mots. Les mots s’étaient joués de moi.
Faut-il rêver de transparence ? Existe-t-il une traduction idéale, absolue ? Ce qui revient à dire : y a-t-il au départ une langue absolue ? La question est liée à un autre débat, plus général : le monde est-il dicible dans sa totalité ? Notre expérience du monde, le vécu, le senti, l’analyse, le réfléchi passent-ils par des mots, des syntagmes, des phrases, des propositions de la représentation parfaite? Ne sommes-nous pas toujours dans une représentation du réel qui se cherche ? Quel est notre rapport intime au réel? Ce rapport ne renferme-t-il pas des substrats émerveillés de nos premiers contacts – cette illusion d’enfance d’être à tout moment immergé dans la totalité du monde, d’avoir le pouvoir magique d’exprimer parfaitement cette totalité ?
On peut imaginer que, dans une situation donnée, chacun reproduit ou traduit (au sens large) avec ses outils propres (sa sensibilité, ses réminiscences, ses oublis, sa culture, son regard critique, son humeur du moment, etc) une matrice mentale en terme d’effervescences, de fantaisies, d’approches, de dérives. Prenons une matrice simple fondée sur trois éléments: sujet + verbe de mouvement + complément de lieu. “Je marche dans un jardin” tendra vers l’expression minimale. “J’avance dans un potager” se contentera d’être une variante faisant appel à des parasynonymes. “Je fais quelques pas parmi les semis” nous propose une extension sur le même thème. “Je me déplace dans un enclos planté d’arbres fruitiers” développe davantage. “Je longe une allée bordée de buis avec, de part et d’autre, des carrés de légumes et quelques arbres fruitiers taillés en espalier”: une fiction s’élabore, la narration s’empare du lieu; un roman pourrait se construire à partir de cet incipit. Que la langue soit au plus près de l’équivalence espace-temps, qu’elle joue sur la contraction ou sur la dilatation par rapport à l’événement considéré, des choix s’opèrent, des sélections qui témoignent tout autant de l’objectivité et de la subjectivité du regard ainsi porté: le je énonce une mesure approximée, insatisfaite, une mesure où les sens (la signification, la sensualité, la direction, l’appréciation, l’intuition) donnent du réel ce qui bouge, ce qui est bougé dans l’acte même de la vie. Mais, me dira-t-on, cette promenade dans un jardin, n’est-ce pas nous égarer, nous mener en bateau ? Ce jardin ne serait-il pas le paradis perdu de la langue absolue? Et puis, ces phrases transformées au gré du locuteur, n’est-ce pas la tentation de remplir du temps par un récit – ce trouble du comportement communément connu sous le nom de complexe de Shéhérazade ? N’est-ce pas le retour de la prose par la porte dérobée ? Ah ! la prose, pourquoi pas ?
Claude Held
« … l’espace du poème »
(texte paru dans le dossier Le traduisible et l’intraduisible publié par la revue La Traductière, N°23, 2005)
À lire au sujet de la traduction ce livre de Claude Held paru chez Propos 2 éditions (avril 2003) : la trace, la traduction, l’écriture.
Claude Held a traduit :
L’amour la mort l’éphémère, poèmes de Frances Horovitz, éditions Tarabuste, 2010 (12 €)
et
Mauvaises herbes, poèmes de Mark Gibbons, Propos 2 éditions, 2010 (15 €)
Les deux livres sont en édition bilingue.
avec l’aimable autorisation de Jacques Rancourt et de la Traductière